La Bibliothèque de Cassini IV (1785-1795)
C’est Cassini IV, dernier en date de la dynastie des astronomes qui ont fondé et dirigé l’Observatoire, qui a créé en 1785 la Bibliothèque de l’Observatoire de Paris.

Dans son projet de restauration de l’Observatoire présenté le 13 mai 1784 au baron de Breteuil, ministre de la maison du roi, Cassini IV fait figurer en bonne place la création d’une bibliothèque. Ce projet, soutenu par le baron de Breteuil, et le comte d’Angiviller, ministre des bâtiments du roi, fut agréé par Louis XVI, malgré le rapport défavorable fait par la commission de l’Académie des sciences réunie à cet effet dans la séance du 4 août 1784.
Dans le règlement du 26 février 1785 portant réorganisation de l’Observatoire Royal, un chapitre est consacré à la Bibliothèque qui arrête et précise diverses dispositions pour son fonctionnement et sa bonne administration (articles 29 à 33) :
- Composition du fonds (livres d’astronomie ou de géométrie appliqués à l’astronomie)
- Inventaire et catalogue
- Droit au prêt, enregistrement, durée, réclamation
- Heures d’ouverture d’été et d’hiver
- Rapport annuel au ministre portant justification des dépenses

L’allocation annuelle de 600 livres, déplore Cassini IV, est plus que suffisante pour le fonctionnement régulier de la bibliothèque mais tout à fait dérisoire pour en constituer les collections. Face à cette situation, Cassini IV fait don d’une partie de sa bibliothèque personnelle et obtient du baron de Breteuil l’autorisation de tirer profit d’un nouveau tirage de la Carte de la Lune de son arrière grand-père pour enrichir les fonds. Les archives sont considérées comme faisant partie intégrante de la Bibliothèque et même comme le cœur de ses collections avec les journaux d’observations faites à l’Observatoire royal de 1671 à 1791.
La Révolution française n’arrête pas la formation de la bibliothèque, bien au contraire. L’État de la bibliothèque de l’Observatoire royal de Paris au 1er avril 1791 recense 285 volumes parmi lesquels la collection complète des 76 volumes des Philosophical transactions, les œuvres d’Hevelius, les mémoires des académies de Berlin, Vienne, St-Petersbourg, Uppsala…, le Journal des Savants. Deux ans plus tard, l’inventaire remis par la Commission des arts du Comité d’instruction publique au citoyen Perny, directeur temporaire de l’Observatoire de la République, fait état de 574 volumes.
Des incertitudes subsistent quant à l’emplacement premier de la Bibliothèque. Peu après sa création une partie des collections auraient été installées dans les salles contiguës à la grande salle méridienne, côté nord-ouest. En 1692, ces salles avaient été partagées en deux étages pour abriter, en bas les machines de l’Académie des sciences, et en haut, un appartement. Après le transfert des machines au Jardin du Roy, le dépôt de la Carte de France de Cassini IV y avait été installé en 1757 et il y resta jusqu’en 1787, date à laquelle il fut transporté rue Maillet, dans la maison de Cassini.
La Bibliothèque sous la tutelle du Bureau des longitudes (1795-1854)
En 1795, la bibliothèque de l’Observatoire s’enrichit considérablement grâce aux collections astronomiques formées par Joseph-Nicolas Delisle (1688-1768).
En vue de la publication d’un Traité complet d’Astronomie, qui ne fut jamais achevé ni publié, Delisle rassembla tout au long de sa vie la plupart des livres astronomiques parus ainsi qu’une immense quantité de manuscrits, originaux ou copies.

A peine devenu membre de l’Académie des Sciences comme élève astronome (1714), il avait fait copier les observations conservées dans les archives de cette Académie. En 1719, il fit l’acquisition des papiers des La Hire lors de la succession de La Hire le fils. La correspondance assidue qu’il entretint avec les principaux astronomes de son temps pendant près de 60 ans (1709-1767) lui permit également de drainer les observations faites de tous côtés.
Appelé en Russie en 1726 à la suite du voyage de Pierre le Grand en France, il noua en chemin des relations avec les principaux astronomes d’Allemagne : Doppelmayer, les frères Rost, Müller, à Nuremberg et à Altorf, Weidler à Wittenberg, Christfried Kirch à Berlin. En passant par Dantzig, il acquit une des pièces capitales de sa collection, la correspondance autographe d’Hevelius et ses journaux d’observations.
Pendant son séjour en Russie, qui dura vingt et un ans, il continua d’enrichir sa bibliothèque par des copies collationnées d’observations quand il ne pouvait acheter les originaux : c’est ainsi qu’il put faire copier et traduire en latin les observations de Gottfried Kirch avant d’acquérir ses registres originaux après la mort de son fils, Christfried.
La correspondance qu’il entretenait avec les missionnaires de Chine, particulièrement avec le Père Gaubil, le mit en possession de manuscrits relatifs à l’astronomie et à la chronologie chinoises. Cette partie de sa collection s’accrut encore notablement quand il eut obtenu une partie des papiers de Nicolas Fréret et la correspondance du Père Souciet.
Seule ombre à ce tableau de collectionneur heureux, selon Guillaume Bigourdan, les manuscrits de Képler qui se trouvaient à Vienne et qu’il ne put obtenir.
De retour en France, Delisle échangea contre une rente viagère et le titre d’astronome de la Marine toutes ses collections qui passèrent vers 1750 au Dépôt de la Marine.
En 1795, le Comité de Salut public décida que la partie astronomique de cette collection serait remise au Bureau des longitudes qui venait d’être fondé. La loi d’établissement du Bureau stipulait en effet (chapitre XVI) qu’il serait « pris dans les dépôts de livres appartenant à la Nation, et dans les doubles de la Bibliothèque nationale, les livres nécessaires pour compléter la Bibliothèque astronomique commencée à l’Observatoire. » Le corps de bibliothèque de Saint-Sulpice fut transporté à l’Observatoire pour loger tous ces livres. Le 21 décembre 1795, un procès-verbal de visite à l’Observatoire signé par 5 membres du Bureau des longitudes (Borda, Laplace, Caroché, Lalande et Delambre), signale que les livres du dépôt de la Marine ont été déposés dans l’appartement du Citoyen Cassini en attendant que les boiseries de la bibliothèque soient en place.

Le Bureau des longitudes prendra un soin extrême de l’installation de la bibliothèque, qui sera longue et coûteuse : une lettre de Méchain datée du 3 mai 1800 signale des travaux de menuiserie de la Bibliothèque à l’étage de la Méridienne. Sous l’égide du Bureau et grâce à ses membres, les dons affluent : les collections s’enrichissent des manuscrits de Le Monnier ; Cassini IV ou son exécuteur testamentaire effectuent plusieurs dépôts de manuscrits relatifs à son projet d’Histoire céleste (1822-1823-1846). En 1840, des manuscrits provenant de Jérôme Lalande et La Caille sont offerts par François Arago à l’Observatoire.
Un poste de secrétaire-bibliothécaire devient de ce fait indispensable. A partir de 1801, les titulaires se succèdent, Marc Agoustenc étant le premier en titre suivi par Auguste Méchain en 1802, François Arago en 1805, Claude Mathieu en 1807…Ce poste disparaît toutefois dans la nouvelle organisation issue du décret de 1854.
Là encore la remise en ordre passe par la réalisation d’inventaires et l’Observatoire dispose de celui qu’a réalisé Ludovic Lalanne, bibliothécaire de l’Institut, en 1850-1851.
Une époque troublée (1854-1877)
La rupture entre le Bureau des longitudes et l’Observatoire de Paris est consommée en 1854, quand Urbain Le Verrier, savant brillant mais aussi ambitieux, rompt avec la tradition de collégialité héritée de la Révolution et se fait nommer Directeur de l’Observatoire de Paris.
Le décret du 30 janvier 1854 portant organisation de l’Observatoire impérial consacre la séparation du Bureau des longitudes et de l’Observatoire et consacre la Bibliothèque comme un enjeu symbolique majeur. L’article 7 ne concède au Bureau l’usage de la bibliothèque commune que pour la seule durée des séances et le règlement annoncé ne sera jamais adopté.
Le procès-verbal du 8 mars 1854 précise que la salle de la bibliothèque située au 2ème étage au nord-ouest de la salle de la méridienne servira désormais pour les réunions du bureau.
Le décret du 3 avril 1868, portant constitution d’un Conseil de l’Observatoire impérial, précise les attributions du personnel et confie la garde des archives et de la bibliothèque au secrétaire, agent comptable. Les journaux scientifiques et ouvrages nouveaux sont désormais placés dans une salle spéciale servant de salle de lecture.

Mais cette réorganisation fait long feu. Les astronomes, qui supportent mal le joug de Le Verrier, adressent en 1870 au Ministre de l’Instruction publique un Mémoire sur l’état actuel de l’Observatoire impérial. Ils y signalent, entre graves dissensions et dysfonctionnements, "que la bibliothèque de l’Observatoire est, ainsi que tous les autres services, dans le désarroi le plus complet. Des collections précieuses sont absentes ou incomplètes. Les livres adressés à l’établissement sont tous reçus par le Directeur qui les donne à son heure au bibliothécaire et c’est souvent bien longtemps après leur arrivée. Une somme de 600 F est allouée chaque année pour la bibliothèque ; cette somme a été refusée cette année au bibliothécaire et employée à un autre usage…"
Par un arrêté du 4 février 1870, le ministre instaure une commission spéciale pour rendre compte de la situation de l’Observatoire, laquelle constate l’échec de la réorganisation de 1868, en impute la responsabilité à Le Verrier et demande qu’il soit relevé de ses fonctions.

Le 3 mars 1870, Charles Eugène Delaunay le remplace. Un décret de 1872 prévoit que l’Observatoire soit régulièrement inspecté par une commission composée de membres du Bureau des longitudes, de deux membres de l’Institut désigné par l’Académie des sciences et de cinq personnes choisies par le Ministre dans les grands corps de l’état. La première commission, en mai 1872, note que Charles Delaunay s’est occupé de mettre en ordre la bibliothèque de l’établissement et l’importante collection de manuscrits qu’il renferme pendant les longs mois du siège de Paris. La Bibliothèque est installée dans la galerie du 1er étage et dans les pièces adjacentes dont une a été disposée en salle de lecture. La bibliothèque est ouverte tous les jours non fériés de 10 h à 4 heures.
Après la mort brutale de Delaunay en 1872 et le retour de Le Verrier à la tête de l’Observatoire, le Bureau des longitudes s’installe rue Mazarine en 1874. Les fonds de la Bibliothèque sont répartis entre les deux institutions mais elle préserve son intégrité : le Bureau n’emporte que des doubles des ouvrages et ses archives, mais non celles de l’Observatoire.
L’essor de la Bibliothèque et du Musée (1878-1926)
L’arrivée de l’amiral Mouchez à la tête de l’Observatoire marque un tournant pour la Bibliothèque et le patrimoine. Son ambition est en effet de doter l’établissement d’un grand musée et d’une bibliothèque moderne...
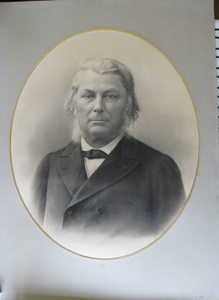
Dès sa nomination en 1878, le contre amiral Mouchez se dote d’un outil précieux pour suivre l’activité de l’Observatoire : les rapports annuels. Grâce à eux, il est possible de retracer désormais tant les recherches conduites dans l’établissement que l’organisation et l’accroissement des collections de la Bibliothèque ou l’émergence du Musée.
Mouchez constate que la situation de la Bibliothèque est préoccupante. Ses collections souffrent d’importantes lacunes pour les ouvrages modernes, ce à quoi il remédie en lui affectant 2.000 francs pour l’acquisition d’ouvrages et leur reliure. L’état des catalogues n’est pas meilleur. Les imprimés sont décrits dans trois registres établis vers 1850 par ordre alphabétique des noms d’auteurs, et où par la suite les livres ont été inscrits au fur et à mesure de leur arrivée. Les mouvements considérables, comme le départ des ouvrages en double au Bureau des longitudes et la remise en 1879 au Bureau central de météorologie de tous les volumes ou brochures météorologiques, n’y ont pas été répercutés. Un catalogue moderne, sur fiches mobiles, a été entrepris en 1871 mais laissé en friche vu l’ampleur de la tâche. Les choses ne vont guère mieux en ce qui concerne les manuscrits : les collections de manuscrits et d’archives ont beaucoup souffert au tournant du siècle : Guglielmo Libri, le plus grand voleur de l’histoire des bibliothèques françaises, a eu ses entrées à l’Observatoire et y a beaucoup sévi. Le catalogue dressé en 1854 ne les décrit que de façon concise et incomplète comme l’a montré le récolement rapide effectué en 1870. Là encore une révision s’impose. A l’évidence, l’agent comptable- bibliothécaire ne peut en venir à bout seul et il est nécessaire de lui adjoindre un personnel spécialisé. La Bibliothèque retrouve sa salle de lecture -occupée un temps par les calculateurs-.
Doté d’un grand sens de l’histoire, Mouchez entend aussi installer à l’Observatoire un grand Musée astronomique. Une collecte de tous les instruments conservés à l’Observatoire est entreprise. Le résultat est maigre, de nombreux instruments ayant été perdus ou détruits. Heureuse trouvaille cependant, de très beaux instruments du XVIe siècle sont dénichés dans un placard des archives. Une dotation de 5000 Francs permettra de les présenter en 1879 au premier étage, dans la salle octogonale de la tour de l’Ouest dans la vitrine centrale. La salle, ornée de portraits des directeurs de l’Observatoire, comporte un médailler , des copies de sphères de Mercator et cinq autres vitrines où sont exposés les étalons du système métrique, les appareils de Fresnel et Arago, de Fizeau et Cornu, ainsi que divers instruments portatifs. En 1881, une deuxième salle est aménagée, la rotonde Est, qui accueille les dessins et photographies qui affluent à l’Observatoire depuis tous les observatoires étrangers.

Dans les années suivantes, le redressement de la bibliothèque et l’accroissement du Musée vont être spectaculaires et parallèles. Sans constituer explicitement un même service, ils entretiennent à l’évidence des ponts étroits, puisque Mouchez porte au crédit de l’enrichissement du Musée les acquisitions de manuscrits qui arrivent nombreux grâce à une politique active d’acquisitions. En 1881, une subvention du Ministère de l’Instruction publique permet ainsi d’acquérir 453 volumes (dont 28 incunables) à la vente de la bibliothèque de l’académicien Michel Chasles. Les dons affluents : manuscrits de la 3e édition du Système du monde de Laplace, calculs de Lalande pour le passage de Vénus sur le Soleil en 1769, observations de l’astronome Flaugergues (de 1782 à 1830), cahiers manuscrits d’Arago, bibliothèque et archives de l’astronome Yvon Villarceau, correspondance entre le baron de Zach et J.J. Lalande (1792-1804)…
Une partie des lettres soustraites par Libri à correspondance d’Hevelius sont remises à l’Observatoire par la Bibliothèque nationale tandis que16 portefeuilles de manuscrits de la collection Delisle, prêtés autrefois à la Russie, sont rendus par M. Struve, directeur de l’Observatoire de Poulkovo.
En dépit des restrictions budgétaires qui s’amorcent en 1886, le fonds de la bibliothèque va connaître un accroissement considérable entre 1879 et 1918, passant de 8 000 à environ 22 500 volumes d’ouvrages et périodiques. Après-guerre, l’accroissement du fonds sera surtout représenté par des publications obtenues par échanges ou dons (périodiques, brochures), en raison du prix élevé qu’atteignent les ouvrages anglais ou américains. On note également quelques dons pour le fonds ancien malgré un ralentissement.
Afin de maintenir les collections à un niveau élevé, un service d’échanges avec la Bibliothèque nationale est institué en 1924 sous la direction de Benjamin Baillaud.
Le travail sur les catalogues sera lent, faute de moyens humains suffisants. L’agent comptable-bibliothécaire, Auguste Fraissinet, qui dirigera la bibliothèque jusqu’en 1909, reçoit toutefois en 1883 l’aide d’un employé de la Bibliothèque de l’Institut pour reprendre le catalogue des ouvrages qui est achevé l’année suivante. Le catalogue des manuscrits sera pour sa part achevé, deux ans après la mort de l’Amiral Mouchez, par Guillaume Bigourdan qui le publie en 1895 dans le tome 21 des Annales de l’Observatoire de Paris sous le titre Inventaire général et sommaire des manuscrits de la Bibliothèque de l’Observatoire de Paris.

Peu avant la première guerre mondiale, les pratiques de description des fonds changent. En 1908 la bibliothèque applique les nouvelles instructions concernant le classement et le catalogage suivant le système prescrit par l’administration supérieure pour les bibliothèques universitaires. En 1913, Léon Bultingaire publie le Catalogue des incunables de la bibliothèque de l’Observatoire de Paris et entreprend pour les publications périodiques un catalogue méthodique dont les divisions sont celles de International catalogue of scientific literature. Malgré un coup d’arrêt dû à la guerre, et avec l’aide de Félix Boquet, ce catalogue de quelque 800 titres est terminé en 1919. Léon Bultingaire entreprend également le dépouillement des principaux périodiques et recueils consacrés à l’astronomie et les publie dans la Revue générale des travaux astronomiques entre 1919 et 1924. Alfred Lacroix, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, le chargera de la coordination et de l’édition de l’Inventaire des périodiques scientifiques des bibliothèques de Paris qui paraît en 1924-1925 et comprendra donc le catalogue des périodiques de la Bibliothèque de l’Observatoire de Paris.
Pour les manuscrits, la suite de l’Inventaire général et sommaire est assurée par l’ouverture en 1921 d’une nouvelle série numérique démarrant au numéro 1001. La même année, un catalogue des 86 médailles commémorant des événements astronomiques ou scientifiques est réalisé. Enfin entre 1922 et 1925, un dépouillement des archives du fonds Delisle est entrepris avec l’établissement d’un index alphabétique.
Quand la bibliothèque de l’Observatoire de Meudon rejoint celle de Paris...

Sous la direction de Henri Deslandres, qui dirige les observatoires de Paris et Meudon désormais réunis, émerge l’idée de créer une bibliothèque à Meudon. Elle se concrétisera sous Ernest Esclangon qui lui accorde en 1928 un poste de secrétaire-bibliothécaire dont le premier titulaire sera M. Lamiable. Amélioration de courte durée cependant car en 1932 ce dernier est nommé secrétaire agent comptable à Paris, le poste de Meudon étant de ce fait supprimé.
Une astronome, Marguerite Roumens, reprend le projet de révision du catalogue et de réaménagement des locaux. La bibliothèque se voit affecter une grande salle en rez-de-chaussée dans le bâtiment des "Communs" dont l’aménagement est terminé au printemps 1933. Des casiers fournis par le conservateur de la Bibliothèque Sainte Geneviève permettront de regrouper les ouvrages déposés dans des locaux annexes. Marguerite Roumens est chargée de la bibliothèque tout en conservant ses fonctions d’assistante du Professeur Pérot. Avec l’aide de M. Bertaud et de Mlle Markoff, elle établit le nouveau catalogue sur fiches auteurs et matières des 12 000 vol. qui composent la bibliothèque, soit 8 000 fiches.
En 1934, un crédit des Beaux-arts permet de réunir en une seule, deux petites pièces du 1erétage attenantes à la salle principale. Ainsi deux salles de lecture sont aménagées, l’une réservée aux périodiques, l’autre aux publications d’Observatoire et aux traités généraux sur l’Astronomie et les sciences connexes.
Devenue Madame d’Azambuja, Marguerite Roumens complète par voie d’échanges avec les académies des sciences de Stockholm, Rome, Tokyo, Léningrad et des observatoires étrangers les collections de périodiques qu’elle fait relier. On recense 80 titres de périodiques et 240 publications d’observatoires, instituts, sociétés savantes.

Toujours sous la direction d’un secrétaire-agent comptable, entre 1926 à 1939, la bibliothèque de Paris voit de son côté croître le nombre de publications d’observatoires (161 titres venant du Japon, de l’URSS, de la Chine, des États d’Europe centrale...) et de tirés-à-part reçus. L’Observatoire de Paris est alors le centre de réexpédition des publications des observatoires français participants aux échanges internationaux.
Ce n’est qu’en 1954, sous la direction d’André Danjon qu’un bibliothécaire diplômé est affecté à l’Observatoire. Par la suite, les salles de lecture et les magasins des deux sites furent aménagés et leur volume accru.
A Paris, la bibliothèque est installée dans le bâtiment Perrault dans l’aile Nord-Ouest à l’étage de la méridienne (2eétage) puis au niveau du 1er étage, de part et d’autre de la grande galerie. En 1956-1957 les salles du 2e étage furent équipées en magasins métalliques auto-porteurs sur trois niveaux desservis par un monte charge, la salle de lecture ou salle des archives se situant au 1er étage. Dix ans plus tard (1965-1966) cette salle fut réaménagée et dotée d’une mezzanine. Le dernier aménagement date de 1997 avec l’installation de la salle de lecture dans la tour de l’ouest.

A Meudon, la Bibliothèque quitte en 1971 les "communs" pour rejoindre le bâtiment construit pour accueillir le Laboratoire d’Astrophysique de Meudon (LAM). Les équipes s’étoffent et se professionnalisent peu à peu sur les deux sites, mais la Bibliothèque garde son unité. Elle devient en 1980 CADIST d’astronomie- astrophysique. En 2006, elle prend le statut de Service Commun de la Documentation et, en 2009, se dote d’une charte documentaire. En 2012 enfin, elle a noué un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France dont elle est désormais "pôle associé".
Depuis 2017, la Bibliothèque a rejoint l’infrastructure de recherche CollEx-Persée.

