Une équipe européenne, conduite par un chercheur de l’Observatoire de Paris, a cartographié une région d’un demi degré carré avec le bolomètre du télescope de 30m de l’IRAM, recherchant l’émission de la poussière dans un hypothétique disque de débris autour d’une étoile proche, à la longueur d’onde de 1.2mm. Elle a trouvé une source lumineuse dans ce champ ou la possibilité d’en trouver une n’était que de 7%. Cette source n’ayant aucune contre-partie optique évidente, ils ont pensé à une jeune étoile cachée par un nuage de molécules et de poussière. Les jeunes étoiles, encore enfouies dans leur cocon de gaz et de poussière, ne sont en effet révélées que par l’émission en millimétrique de la poussière qu’elles chauffent. Dans cette hypothèse, il devrait exister un nuage de gaz moléculaire proche, dont les raies d’émission des molécules CO est le traceur le plus facile à détecter. La recherche de raies CO avec le télescope KOSMA de 3 mètres de diamètre n’a rien donné. Il y a donc bien une source de poussière, mais pas de molécules proches. L’équipe a alors entrepris la recherche passionnante d’une possible galaxie très distante, qui pourrait être un objet très lumineux de l’univers jeune. Les raies moléculaires dans le domaine millimétrique sont l’un des meilleurs moyens de trouver le redshift, et donc la distance et la nature d’un tel objet. La recherche a été rendue possible grâce à un récepteur perfectionné à grande largeur de bande (EMIR), nouvellement installé sur le télescope de l’IRAM, possédant une largeur instantanée de presque 8 gigahertz. Dans un si grand intervalle de fréquence, il n’est pas improbable de trouver une des raies de rotation de la molécule de CO. L’espacement entre les raies successives est même réduit par le redshift, facilitant la recherche. Cependant la détection d’au moins deux raies est nécessaire pour toute identification. La recherche a commencé par un balayage de toute la bande à 3 millimètres, ce qui exige 5 réglages de fréquence, de 2 heures d’intégration chacun. Les astronomes ont eu de la chance, et ont trouvé une première raie après seulement 20minutes d’intégration pendant le 3ème réglage. À ce stade, ils ont fait des hypothèses, à savoir quelle raie de CO avait été détectée, et ont déduit quel était le réglage optimal à plus haute fréquence pour confirmer et déterminer définitivement le redshift. La première raie était CO(4-3) et la deuxième CO(6-5) (voir Figure 1). On a pu ainsi obtenir une détermination très précise du redshift : z = 3.92960 ± 0.00013. En tout, trois raies de CO et deux raies du carbone atomique ont été détectées.
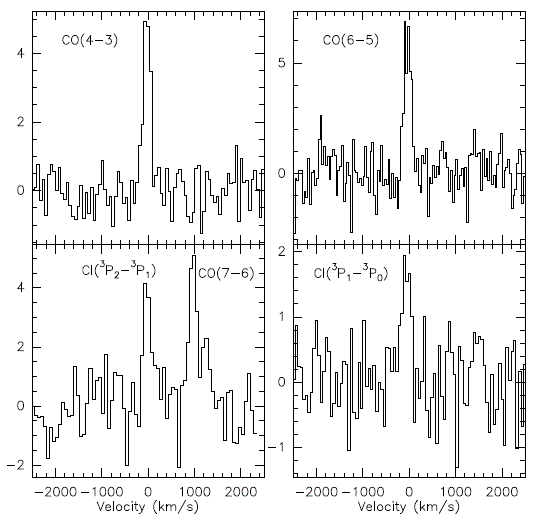
L’analyse de la répartition spectrale de l’énergie (cf Figure 2) prouve que la majorité de la poussière est chauffée à une température de 45K. A partir des raies observées de CO, on obtient une masse de gaz comprise entre 1.9 et 11x1011. Cette valeur est beaucoup plus grande que ce à quoi on s’attend pour une galaxie, et le flux observé résulte probablement d’une puissante amplification par une lentille gravitationnelle. L’excitation modérée des raies de CO exclut un chauffage dominé par l’activité nucléaire d’un trou noir.
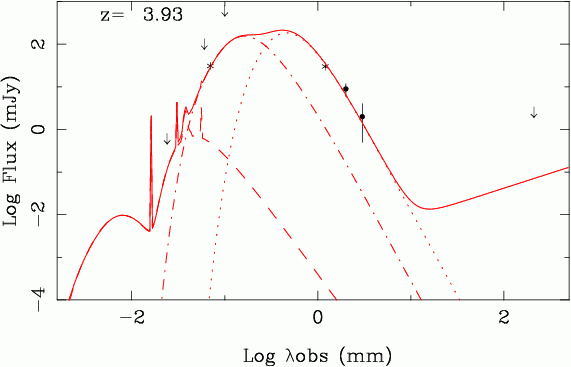
D’autres observations à plus haute résolution spatiale doivent maintenant être engagées, afin de rechercher des images multiples et des signatures de la lentille gravitationnelle, pour mieux caractériser cette source exceptionnelle MM 18423+5938. Selon le facteur d’amplification, la source pourrait être une galaxie infrarouge lumineuse simple (LIRG), comme les galaxies en interaction des « Antennes », de la figure 3a, ou une galaxie Infrarouge Ultralumineuse (ULIRG) comme le système de galaxies en fusion Arp 220, de la figure 3b, ou un système submillimétrique hyperlumineux. Nous pouvons aussi prédire que l’objet va nous apparaître sous la forme de plusieurs images, comme le quasar du "Trèfle à quatre feuilles", de la figure 3c, ou va s’étaler dans un anneau d’Einstein, comme dans la figure 3d.

Référence Discovery of an Extremely Bright Sub-Millimeter Galaxy at z=3.93 J.-F. Lestrade (Obs-Paris), F. Combes (Obs-Paris), P. Salomé (Obs-Paris), A. Omont (IAP), F. Bertoldi (Bonn), P. André (CEA), N. Schneider (CEA) Astronomy and Astrophysics, accepté pour publication Contact Jean-Francois Lestrade (Observatoire de Paris, LERMA et CNRS)
Francoise Combes (Observatoire de Paris, LERMA et CNRS)
Philippe Salomé (Observatoire de Paris, LERMA et CNRS)
