Parmi les quelques 430 exoplanètes découvertes à ce jour, une petite centaine a le bon goût de passer régulièrement devant son étoile, vue depuis l’observateur. On dit que ces planètes sont « en transit » devant leur étoile. L’intérêt immense de cette catégorie de planètes est que leur atmosphère absorbe des raies moléculaires de l’atmosphère de la planète pendant le transit. L’observation spectroscopique de ces raies permet donc de savoir quelles molécules sont présentes dans cette atmosphère et en quelle quantité. Jusqu’à présent, toutes les planètes en transit se trouvaient tellement près de leur étoile que leur température dépassait 1300 degrés Celsius. C’est pourquoi on les qualifie de chaudes : Jupiters ou super-Terres chaud(e)s selon les cas.
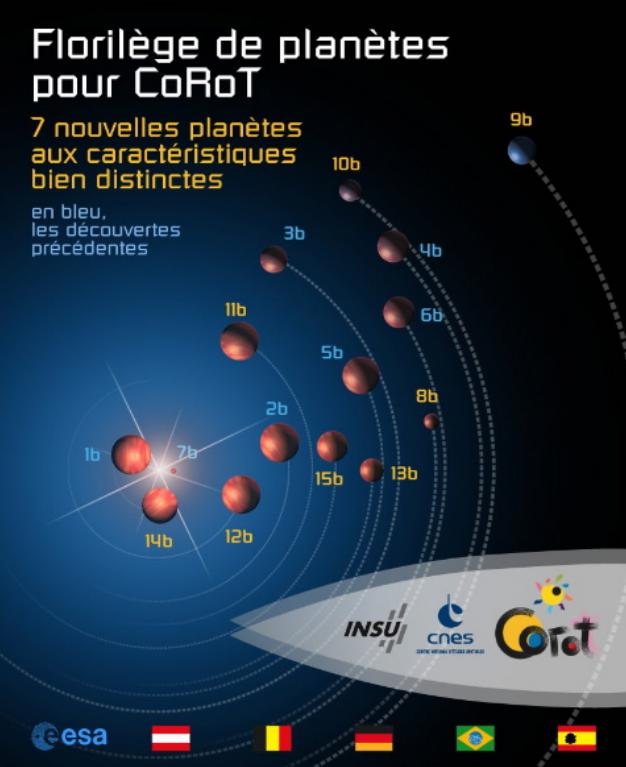
Ce qui est nouveau avec CoRoT-9b, c’est que, avec une période orbitale de 95 jours sur une orbite très légèrement elliptique, elle doit se trouver à une distance d’environ 0,4 unité astronomique de son étoile, soit environ la distance de Mercure au Soleil (l’unité astronomique est la distance Terre-Soleil). Cette planète est chauffée par la lumière de son étoile. Celle-ci étant légèrement moins lumineuse que le soleil, CoRoT-9 b doit être légèrement plus froide que Mercure. Sa température exacte dépend de son pouvoir à absorber le flux lumineux de son étoile. Comme l’orbite est légèrement elliptique (l’excentricité est de 0,1 environ), la température doit varier, selon l’efficacité de son effet de serre, entre -20 et 160 degrés C. Cela la placerait comme la planète géante la plus froide détectée à ce jour par transit. Si cette planète avait un satellite de type Titan ou Encelade, celui-ci pourrait donc éventuellement être « habitable » (c’est-à-dire contenir de l’eau liquide) si la fourchette de température se resserre autour de 0-50 degrés C. De plus étant constamment assez loin de son étoile, elle ne subit pas de déformation interne qui serait due à des effets de marée. Il n’y a donc pas de ce coté de source de chaleur interne ce qui facilite la construction des modèles pour cette planète.
Avec cette planète on entre dans un nouveau régime de température par rapport aux planètes déjà connues, intermédiaire entre celui des Jupiters chauds (dont la température est voisine de 1000 degrés C) et de notre Jupiter (dont la température est de -100 degrés C environ). Ce n’est pas la première fois que l’on trouve des Jupiters "tempérés" (on en connaît déjà quelques dizaines), mais c’est la première fois que l’on en trouve un en transit devant son étoile. On pourra donc faire ultérieurement la spectroscopie de ce transit dans des conditions thermiques inexplorées à ce jour. Cette spectroscopie pourra être faite soit depuis le sol avec le Very Large Télescope européen installé au Chili par exemple ou depuis l’espace avec le télescope Hubble, et mieux, à partir de 2014 avec le James Web Space Telescope, et peut-être en 2018 avec les projets Plato et Spica (sélectionnés par l’ESA pour une étude de faisabilité). Ces observations permettront de voir comment les "équilibres chimiques" de l’atmosphère des planètes (c’est-à-dire par exemple l’abondance de dioxyde de carbone par rapport à celle du méthane) dépendent de leur température et de détecter des molécules stables à la température de CoRoT-9b mais instables à la température des Jupiters chauds.
Après une période de statistique des observations, l’ère de l’exoplanétologie comparée semble désormais bien ouverte et on peut parier qu’elle ménagera de nouvelles surprises. On peut compter pour cela, du côté européen, sur les futures observations dans les proches années à venir avec la caméra Sphere installée sur le Very Large Telescope européen au Chili, et le futur Extremely Large Telescope européen pour le sol, Gaia et le James Web Space Telescope dans l’espace. L’Observatoire de Paris est présent dans la réalisation de ces quatre futurs moyens comme il le sera dans leur exploitation.
Note 1 : La période totale d’observation de CoRoT pour cette étoile a été de 140 jours. Avec une période orbitale de 95 jours pour CoRoT-9b, le satellite n’a pu observer que 2 transits de la planète devant son étoile
Voir aussi : ESO Press-Release
Référence
- H.J. Deeg, C. Moutou, A. Erikson, Sz. Csizmadia, B. Tingley, P. Barge, H. Bruntt, M. Havel, S. Aigrain, J.M. Almenara, R. Alonso, M. Auvergne, A. Baglin, M. Barbieri, W. Benz, A. S. Bonomo, P. Bordé, F. Bouchy, J. Cabrera, L. Carone, S. Carpano, M. Deleuil, R. Dvorak, S. Ferraz-Mello, M. Fridlund, D. Gandolfi, J.-C. Gazzano, M. Gillon, P. Gondoin, E. Guenther, T. Guillot, R. den Hartog, A. Hatzes, M. Hidas, G. Hébrard, L. Jorda, P. Kabath, H. Lammer, A. Léger, T. Lister, A. Llebaria, C. Lovis, M. Mayor, T. Mazeh, M. Ollivier, M. Pätzold, F. Pepe, F. Pont, D. Queloz, M. Rabus, H. Rauer, D. Rouan, J. Schneider, A. Shporer, B. Stecklum, R. Street, S. Udry, J. Weingrill et G. Wuchterl A transiting giant planet with a temperature between 250 K and 430 K Nature, Mars 2010 Institutions participantes : Observatoire de Paris (LESIA et LUTh, CNRS, UPMC, Univ Paris-Diderot), Instituto de Astrofisica de Canarias, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, German Aerospace Center, U. of Exeter, Observatoire de Genève, Universität Bern, IAS Orsay, IAP, Universitä zu Köln, ESA/ESTEC, University of Vienna, Universidade de Sao Paulo, Thüringer Landessternwarte, University of Liège, OCA, Las Cumbres Observatory, Space Research Institute Graz, Tel Aviv University, University of Sydney, Universita di Padova, OHP, Oxford Astrophysics et CalTech.
Voir aussi CNES
