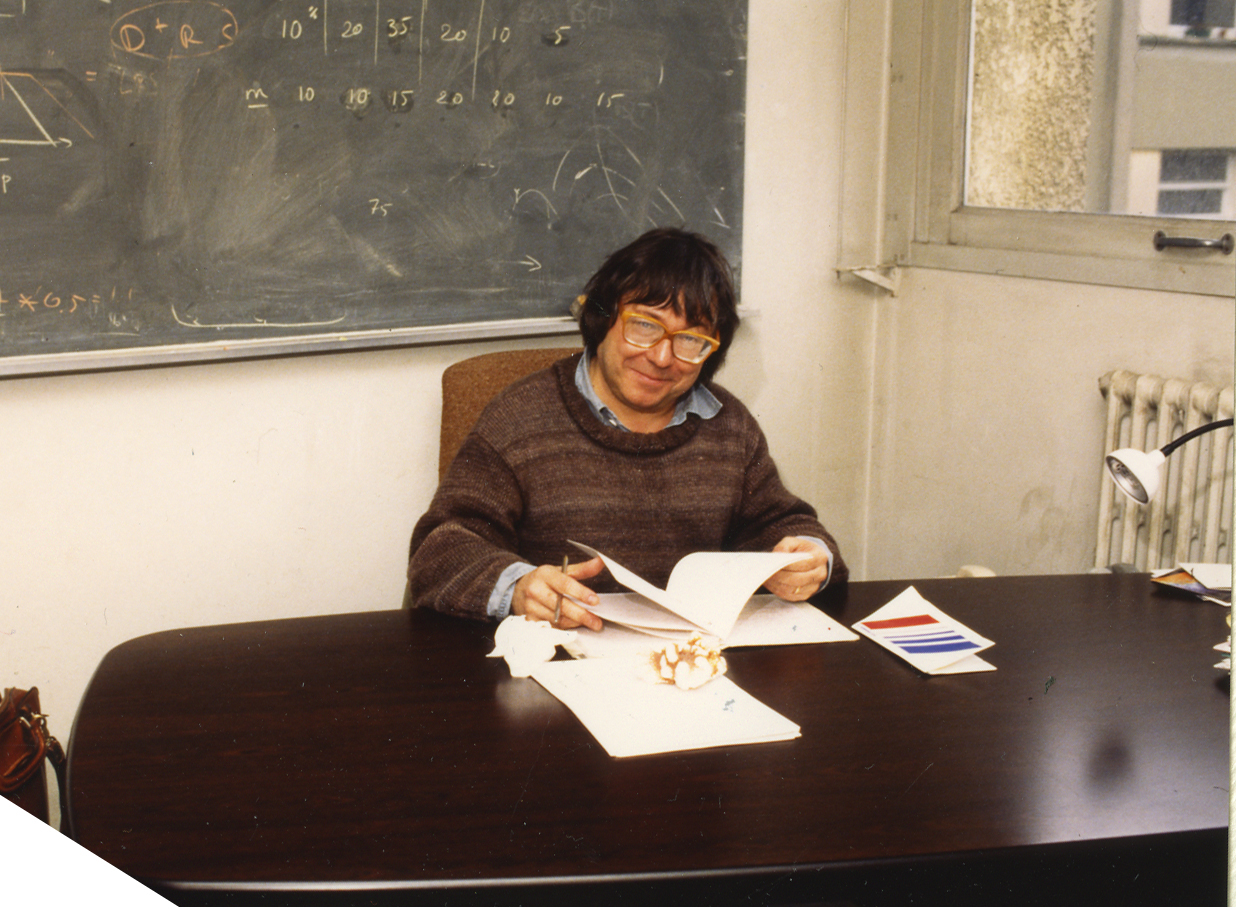Ancien élève de l’Institut d’Optique, Michel Combes intègre l’Observatoire de Paris au début des années 1960, dans le groupe de la "Caméra Électronique" que dirige alors André Lallemand.
Précurseur de la spectro-imagerie infrarouge spatiale
En 1969, suite au séjour à Paris de S. I. Rasool, impliqué à la NASA dans l’exploration spatiale planétaire, Michel Combes joue un rôle crucial dans la création à l’Observatoire d’un nouveau groupe de planétologie, le « Groupe Planètes », alors hébergé au Département de Physique Solaire qui deviendra par la suite le DASOP, puis le LESIA.
Opticien dans l’âme, Michel est convaincu que les nouveaux projets doivent s’appuyer sur des innovations instrumentales. Avec James Lequeux, il propose des solutions novatrices pour le télescope Canada-France-Hawaii, mais probablement trop novatrices pour qu’elles aient pu être adoptées.
En 1973, il monte une campagne en Afrique du Sud pour observer l’occultation de l’étoile Beta Scorpio par Jupiter. L’expérience est un plein succès, et permet pour la première fois une analyse de la structure thermique de la stratosphère de Jupiter.
En parallèle, il travaille au développement d’un spectromètre à Transformée de Fourier dans l’infrarouge thermique, dédié à l’analyse spectroscopique de Jupiter. C’est l’instrument ROMEO I qui sera embarqué sur le Kuiper Airborne Observatory en 1973, et qui sera monté à plusieurs reprises sur le télescope de 2,20m de l’Université de Hawaii et sur le 3,60m de l’ESO à La Silla.
Il est suivi d’un autre instrument plus sophistiqué, ROMEO II, qui fonctionnera lui aussi à La Silla au début des années 1980. Ces campagnes permettront d’analyser la composition de l’atmosphère de Jupiter et d’en déterminer les rapports d’abondance, permettant ainsi de contraindre les modèles de formation de la planète.
La décennie 1980 est celle de l’apparition de la Comète de Halley ; Michel Combes souhaite tirer parti de cette opportunité unique. Avec Tobias Owen aux Etats-Unis et Vassili Moroz en URSS, à Moscou, il soumet une proposition pour un nouvel instrument dédié à une observation inédite, celle de l’émission des comètes dans l’infrarouge proche.
Pour réaliser cette expérience spatiale, Michel a fait en sorte que le Groupe "Planètes" rejoigne le DESPA, alors dirigé par Jean-Louis Steinberg.
En collaboration avec plusieurs collègues du LPSP (ancêtre de l’Institut d’Astrophysique Spatial) et du CSNSM à Orsay, Michel Combes travaille au développement de cet instrument – IKS - qui doit être réalisé dans des délais très courts, et en devient le responsable scientifique.

Cette expérience, lancée sur les sondes soviétiques Vega 1 et Vega 2, sera un plein succès, avec la première mesure de la température du noyau et la détection de nouvelles molécules-mères issues du noyau.
Dans le milieu des années 1980, Michel Combes prend la direction du DESPA et rend possible son élargissement avec l’insertion du Groupe "Infrarouge Spatial". Il embarque alors le laboratoire dans la réalisation de l’une des voies de la caméra ISOCAM de la mission Infrared Space Observatory (ISO) de l’ESA.
En parallèle, dans la continuité de l’expérience IKS, il engage l’équipe de planétologie vers des missions de sondage infrarouge planétaire. Ainsi naît une filière de spectro-imageurs infrarouges conçus et réalisés au DESPA, en partenariat avec l’IAS et d’autres laboratoires internationaux.
Ils sont d’abord embarqués sur des missions martiennes avec les instruments ISM/PHOBOS puis OMEGA/Mars-96 avec la Russie, qui sera repris après l’échec de Mars 96 sur Mars Express.

Ils inspireront les spectro-imageurs de Cassini/Huygens, de Rosetta et Venus Express.
Tous les instruments et sous-systèmes développés au DESPA fonctionneront avec succès, en particulier ceux de la mission Mars Express, toujours en opération autour de Mars.
Deux mandats de Président
En janvier 1990, suite au décès de Pierre Charvin, Michel assure sa succession à la présidence de l’Observatoire de Paris. Dans cette fonction, il donne la mesure de ses remarquables qualités humaines, et de sa connaissance des hommes et des institutions qu’il a notamment acquise en tant que membre du Bureau national du Syndicat National de l’Enseignement Supérieur dans les années 1960.
A la présidence de l’Observatoire, le principal chantier de Michel Combes est l’initiation d’une restructuration des départements, une opération délicate qui suscite de nombreux débats et controverses. Michel arbitre les conflits dans le respect des personnes et des points de vue.
Un nouveau département d’astronomie millimétrique, le DEMIRM, est créé en 1994 ; le service de calcul du Bureau des Longitudes rejoint l’Observatoire (IMCCE) en 1996 ; le Centre d’Analyse d’Images (CAI) est créé et rejoint le DASGAL en 1998. Ce sont les premières étapes d’une vaste restructuration de l’ensemble des départements scientifiques de l’Observatoire, qui sera conclue sous la présidence de Pierre Couturier au début des années 2000.
Lors de ses deux mandats à la présidence de l’Observatoire, Michel assure également la présidence du CNAP (Conseil National des Astronomes et Physiciens).
Malgré ses lourdes charges administratives, il continue à accompagner le développement des projets spatiaux du DESPA et l’élargissement vers de nouveaux domaines, en particulier l’expérience de photométrie stellaire EVRIS embarquée avec OMEGA à bord de la mission russe Mars-96.
Suite à l’échec de la mise en orbite de la sonde Mars-96, les expériences EVRIS et OMEGA seront redéveloppées dans un nouveau contexte.
Toujours sous la responsabilité d’Annie Baglin, EVRIS deviendra la mission française CoRoT, première mission spatiale dédiée à la sismologie stellaire et l’exploration des exoplanètes ;
OMEGA renaît dans le contexte de la mission européenne Mars Express, toujours sous la responsabilité scientifique de Jean-Pierre Bibring à l’IAS.
Plus tard, en collaboration avec l’équipe d’Angioletta Coradini (INAF-IFSA) à Rome et d’autres partenaires européens, l’expérience VIRTIS-H sera embarquée sur deux missions européennes, Rosetta et Venus Express.
En 1999, après ses deux mandats passés à la tête de l’Observatoire de Paris, il quitte la présidence et revient au DESPA (ex-LESIA) pour travailler avec Loïc Vapillon à un projet scientifique qui lui tient à cœur, l’analyse des images de Titan obtenues par optique adaptative.
Il se consacre à des tâches d’enseignement dans le domaine de l’optique. Il participe aussi à des actions de Recherche et Technologie concernant les spectro-imageurs infrarouges, et continue le suivi des développements instrumentaux.
Il accompagne et épaule la Direction de la Communication et contribue largement aux activités de l’équipe d’Histoire des Sciences aux côtés de son ami Jean Eisenstadt, activités qu’il assurera jusqu’à la fin de sa vie.

La disparition de Michel laisse un grand vide parmi tous ses collègues et amis. Sa forte personnalité, sa clairvoyance politique aiguë, son engagement dans la société, son sens de l’organisation et du dialogue lui ont permis de jouer un rôle majeur dans le domaine de la planétologie mais aussi au niveau de l’Observatoire et au-delà.