Les scientifiques savent depuis longtemps que les trous noirs de quelques millions de masses solaires, présents dans la plupart des centres galactiques, peuvent briser les étoiles qui s’approchent trop près. En raison de forces de marée très intenses, la gravité du trou noir attire en effet plus fortement la partie avant de l’étoile que sa partie arrière, provoquant ainsi un déséquilibre qui, en quelques heures seulement, déchire l’étoile tout entière au sein de ce que l’on appelle le "rayon de marée".
Selon une étude récente de Matthieu Brassart et Jean-Pierre Luminet, de l’Observatoire de Paris (section de Meudon), l’intensité des forces de marée peut aussi déclencher des réactions thermonucléaires suffisamment puissantes pour faire exploser l’étoile depuis l’intérieur. A l’aide de simulations numériques, ils ont étudié les derniers instants d’un étoile condammée, dès lors qu’elle pénètre profondément dans le rayon de marée d’un trou géant.

Lorsque l’étoile s’approche suffisamment près du trou noir (sans toutefois tomber dedans), les forces de marée l’aplatissent en une configuration de "crêpe". Des calculs déjà effectués il y a vingt ans par Luminet et ses collaborateurs avaient suggéré que l’écrasement de l’étoile augmenterait la densité et la température centrales à des valeurs suffisantes pour déclencher des réactions thermonucléaires explosives. Mais d’autres travaux avaient suggéré que le processus serait modifié par des ondes de choc engendrées au sein de la crêpe, de sorte qu’aucune explosion nucléaire ne se produirait.
Les nouvelles simulations étudient en détail les effets des ondes de choc, et montrent que les conditions créées favorisent toujours une explosion thermonucléaire qui brisera complètement l’étoile, et sera suffisamment puissante pour propulser une bonne partie du gaz libéré hors d’atteinte du trou noir.

Feux d’artifice stellaires
La rupture d’étoiles par les forces de marée de trous noirs a probablement déjà été observée par les télescopes à rayons X comme GALEX, XMM et Chandra, bien qu’à un stade beaucoup plus tardif : en effet, plusieurs mois après l’événement qui a brisé l’étoile, une partie du gaz libéré tombe en spirale vers le trou noir, s’échauffe et libère du rayonnement UV et X. Toutefois, si les crêpes stellaires explosent bel et bien, elles permettraient de détecter ces ruptures beaucoup plus tôt. Les futurs instruments comme le LSST (Large Synoptic Survey Telescope), qui recensera les supernovae en grand nombre, pourront repérer des explosions de ce type.
Mais le sort d’une crêpe stellaire pourait s’avérer encore plus spectaculaire. Brassart et Luminet ont calculé que les ondes de choc engendrées dans la crêpe transportent un pic de température bref (< 0.1 s) mais très intense (plus de 109 K) depuis le coeur de l’étoile vers sa surface. Ce dernier résultat est très prometteur, car il pourrait donner naissance à un nouveau type de sursaut X ou gamma qui permettrait de voir instantanément la rupture de l’étoile.
La fréquence de telles « flambées » est estimée à environ 10-5 par an par galaxie. Comme la plupart des galaxies — y compris notre propre Voie Lactée — abritent un trou noir massif en leur centre, et comme l’univers est transparent aux rayonnements X durs et gamma, plusieurs événements de ce type seraient détectables chaque année dans l’ensemble de l’univers observable.
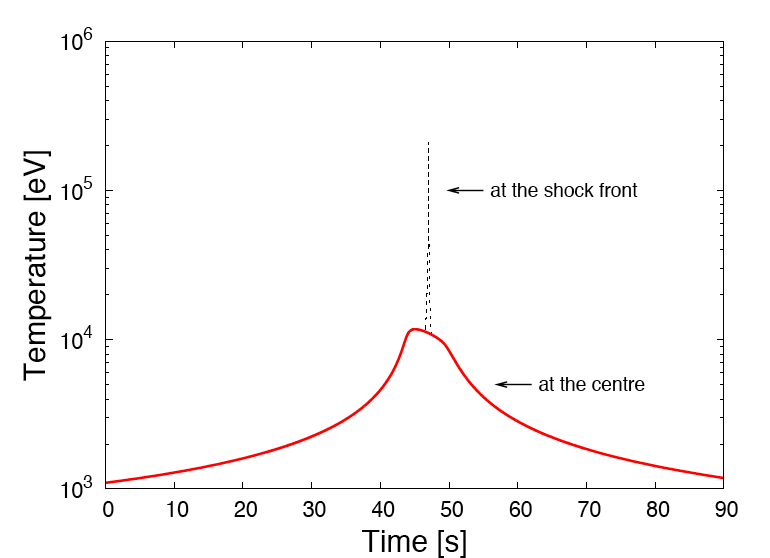
Conclusion
Les projets de sondages du ciel aux hautes énergies et à vaste couverture angulaire seront les mieux à même de détecter des flambées de ce type. En permettant une localisation rapide des crêpes stellaires, relayée par la détection de leurs lueurs résiduelles en optique, infrarouge et radio par les télescopes au sol, ces missions spatiales pourront apporter à la connaissance des dislocations stellaires autant que les télescopes Beppo-Sax et Swift ont jadis apporté à la compréhension des sursauts gamma.

