Les étoiles massives, de quelques dizaines, voire une centaine de masses solaires, sont encore très mal connues. Leur durée de vie est très courte, de quelques millions d’années seulement, et elles ont à peine le temps de sortir du nuage moléculaire qui leur a donné naissance. Elles restent cachées pendant une fraction importante de leur vie à l’intérieur d’un "cocon" opaque de matière et de poussière. La pression de rayonnement sur les grains poussière limite l’accrétion de gaz, et la masse de l’étoile finale. C’est pourquoi dans les galaxies à faible métallicité, donc faible abondance de poussières comme le petit Nuage de Magellan, on peut espérer trouver plus d’étoiles massives.
M. Heydari-Malayeri et ses collaborateurs ont donc utilisé la haute résolution spatiale du Hubble Space Telescope pour résoudre une région compacte, d’un type très rare, de formation d’ étoiles massives. La qualité exceptionnelle des images permet pour la première fois de pénétrer à l’intérieur de cette région appelée N88 qui se trouve dans le Petit Nuage de Magellan.
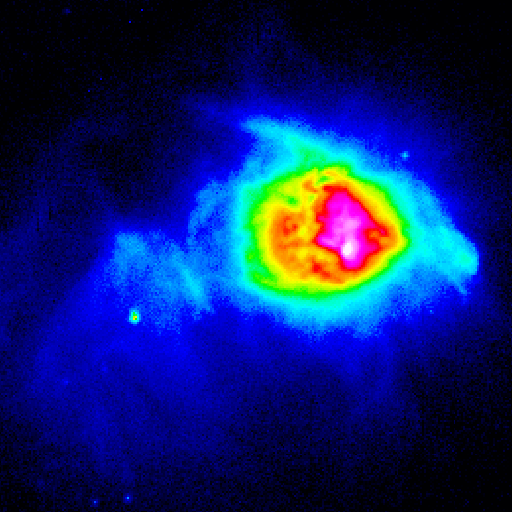
Les images montrent que la région est composée de deux nébulosités en interaction (ci-dessus une image H-alpha en fausses-couleurs). La plus jeune et la plus compacte, nommée N88A (d’un diamètre de 3.5 seconde d’arc, correspondant à environ 3 années-lumière), est engendrée par des étoiles massives qui viennent de naître. Deux de ces étoiles au moins sont enfouies dans une quantitié extrémement élevée de poussière, étonnante pour une telle galaxie. Une bande de poussière traversant la nébuleuse du nord au sud est un vestige du nuage de matière interstellaire parental. Le puissant rayonnement des étoiles massives nouvellement formées, a dissocié les molécules et ionisé le nuage environnant. Quant à la composante N88B, sa source centrale est une étoile multiple animée d’un vent très violent (elle éjecte sa matière à des taux très élevés) qui interagit et sculpte le milieu environnant. Des études photométriques à plus grande échelle de cette région permettent de déterminer la chronologie de la formation stellaire dans cette partie du Petit Nuage de Magellan.
Heydari-Malayeri M.( Obs Paris), Charmandaris V.(Obs Paris et Cornell, USA), Deharveng L.(Obs Marseille), Rosa M.R.(ESO), Zinnecker H.(Postdam Inst.) (1999) Astronomy and Astrophysics, 347, 841
Pour plus d’informations et d’images en vraies-couleurs, cliquez ici.
